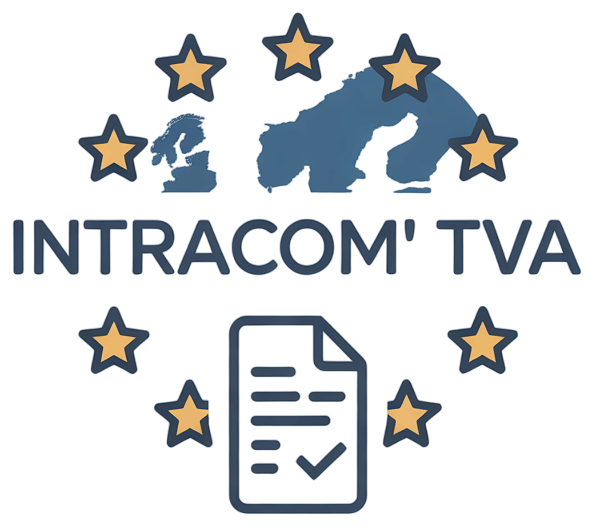Pour illustrer le principe de la marketplace redevable de la TVA, je vous propose d’aborder quelques cas pratiques auxquels je suis fréquemment confrontée dans mes missions de conseil auprès de e-commerçants et d’entrepreneurs. Bien entendu, chaque situation peut varier selon la localisation précise des parties, le type de produits vendus et le volume d’activité, mais ces exemples permettent d’avoir un premier aperçu.
Vendeur non-UE qui dépasse le seuil de 10 000 euros
Imaginez une société basée aux États-Unis, vendant des accessoires de mode (chaussures, sacs, etc.) à des consommateurs français, belges et allemands via une marketplace bien connue. Avant la réforme, la société américaine se contentait souvent de facturer sa propre taxe à ses clients ou ignorait, par méconnaissance, qu’il fallait appliquer la TVA de chaque pays de consommation. Depuis la mise en place de l’OSS, cette société devrait s’enregistrer et collecter la TVA européenne correspondante. Toutefois, parce qu’elle n’est ni établie ni immatriculée dans l’UE, et qu’elle dépasse le seuil de 10 000 euros, c’est la marketplace qui se retrouve chargée de collecter la TVA sur les ventes B2C.
Dans ce schéma, la plateforme facture la TVA directement au client final et la reverse à l’administration du pays concerné. Du point de vue de la société américaine, elle perçoit donc le prix HT (hors TVA) de chaque article. La marketplace, elle, a un double intérêt : d’une part, respecter la loi pour éviter d’éventuelles sanctions ; d’autre part, maintenir un climat de confiance vis-à-vis de ses vendeurs et des autorités fiscales, car un manquement peut lui coûter cher en termes de pénalités. Les vendeurs non-UE doivent donc s’assurer que tous leurs produits, stocks et prix sont correctement paramétrés pour respecter la législation de chaque pays membre.
Petite entreprise française en dropshipping
Autre exemple : un micro-entrepreneur français décide de se lancer dans le dropshipping en s’approvisionnant principalement en Chine. Ses ventes démarraient plutôt doucement, mais il a connu une croissance fulgurante après s’être inscrit sur une marketplace généraliste, atteignant 15 000 euros de chiffre d’affaires à distance en quelques mois. Avant la réforme, il aurait dû s’enregistrer individuellement pour chacun des pays vers lesquels il vendait, mais l’OSS simplifie partiellement cette gestion.
Néanmoins, puisqu’il importe des marchandises de Chine, l’entrée des biens sur le territoire douanier européen soulève la question de la TVA à l’importation. Certains petits colis bénéficient d’un régime d’exonération ou du IOSS si la valeur des marchandises ne dépasse pas un certain montant (autour de 150 euros). Or, s’il ne se plie pas aux formalités prévues par l’IOSS ou s’il ne respecte pas les procédures de dédouanement, la marketplace peut se retrouver dans l’obligation de collecter la TVA lors de la vente finale et d’assumer toutes les démarches déclaratives. Cela peut évoluer selon le type de produit, la répartition géographique des commandes et la capacité du dropshipper à gérer l’OSS.
Dans les faits, la petite entreprise française aura également à cœur de préserver sa relation avec la plateforme, car un risque de non-conformité peut mener à la fermeture du compte vendeur. De plus, les places de marché, soucieuses de protéger leur réputation, imposent souvent des procédures de vérification avant de valider l’ouverture d’un compte vendeur. Elles demandent parfois un justificatif de numéro de TVA intracommunautaire, voire une attestation de respect de la réglementation douanière et fiscale.