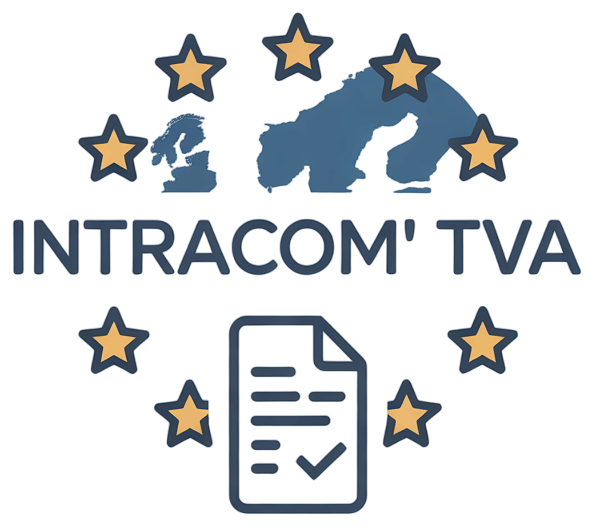Pour commencer, il faut savoir que l’auto‑liquidation de la TVA ne s’applique pas qu’aux échanges de biens : elle vise également des prestations de services réalisées entre assujettis à la TVA, établis dans différents États membres de l’Union européenne. Le fait de transférer la charge de la TVA au preneur de services est un mécanisme qui sert en principe à simplifier les relations fiscales entre entreprises de pays distincts. Concrètement, quand vous recevez une facture d’un prestataire étranger (dans l’UE) pour une prestation de services, c’est vous, en tant que client, qui devez calculer et reporter la TVA potentielle sur votre propre déclaration dans votre pays.
Pour prendre un exemple : imaginons qu’une entreprise basée en France commande un service informatique à une société en Allemagne. Au lieu que le prestataire allemand facture la TVA allemande, la TVA n’apparaît pas sur la facture, étant donné que c’est la société française qui va reverser la TVA française via sa propre déclaration. L’entreprise française doit donc mentionner elle‑même la base de TVA sur laquelle elle calcule ensuite le montant à reverser. En général, la contrepartie est qu’elle déduit immédiatement la même somme si elle a le droit à déduction, rendant ainsi l’opération globalement neutre.
Cette simplification vise à éviter les procédures de remboursement de TVA dans un autre État membre. À première vue, le procédé paraît simple. Pourtant, il recèle plusieurs difficultés pratiques qu’il convient de bien cerner : nature du service, localisation du preneur, identification précise de l’entreprise facturant la prestation, etc. Sans cette attention, il arrive souvent que certaines entreprises se retrouvent, à leur insu, en infraction, écopant de redressements fiscaux et autres pénalités.
Identifier clairement la localisation du preneur et la qualification du service
Le premier piège consiste souvent à mal évaluer la localisation du preneur ou à se tromper sur ce qui constitue une prestation de services éligible à l’auto‑liquidation selon les règles de TVA intracommunautaire. Le principe général stipule que la TVA est due dans l’État d’établissement du preneur lorsque celui‑ci est assujetti. Cependant, certaines exceptions existent, notamment pour des prestations relatives à des biens immobiliers, au transport ou aux événements culturels, qui peuvent obéir à des règles particulières de lieu d’imposition.
Une erreur fréquente consiste également à confondre les services avec des livraisons de biens qui, elles, sont soumises aux règles différentes des « livraisons intracommunautaires ». Assurez‑vous donc d’identifier avec précision la nature de l’opération réalisée. En cas de doute, rapprochez‑vous d’un expert ou vérifiez dans la documentation fiscale de votre pays les codes et catégories de TVA susceptibles de s’appliquer.
Dans la majorité des situations courantes, toutefois, la prestation de services s’analyse à travers cette question : « Le client est‑il un assujetti TVA établi dans l’UE hors de mon pays ? ». Si la réponse est oui, la TVA due relève le plus souvent de l’auto‑liquidation par le client. À l’inverse, si votre destinataire est un client particulier, sans numéro de TVA intracommunautaire, ou si son activité est exonérée, voire s’il est établi hors de l’UE, les mécanismes peuvent changer.